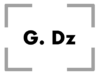Erol Bey, retoucheur à Firuzaga
Sur les dix années qu’a duré mon séjour initiatique stambouliote, j’en ai vécu huit à Cihangir, un quartier bobo du centre ville. Cihangir? Pas vraiment en fait… j’habitais à Firuzaga, une zone populaire attenante qui n’avait pas encore connu les affres de la gentrification. Il faudrait attendre quelques années pour voir des cafés branchouilles pousser comme des champignons là où se tenaient encore merceries, fours à pain et autres commerces prolétariens, uniformisant ainsi l’ensemble du quartier. Mais pour simplifier, et aussi parce que c’était plus classe, nous étions nombreux parmi les habitants de Firuzaga (jeunes et/ou expats) à dire, l’air fier, « J’habite à Cihangir ».
Près des hauts murs jaunes de l’école élémentaire, à deux pas de la mosquée et des petits salon de thé en plein air, vivait un vieil homme. Retoucheur de son état, Erol Bey cousait et reprisait patiemment des vêtements contre quelques sous dans la minuscule boutique sise au rez-de-chaussée de son habitation. Francophone, il était heureux de pratiquer avec les étrangers — Français et autres — et aimait parsemer notre conversation de proverbes appris à l’école. « Petit à petit, l’oiseau fait son nid ». Son métier et son éducation indiquaient une lignée arménienne, mais lui insistait sur le fait qu’il était turc. Pour vivre heureux, vivons caché…
En février 2011, Erol Bey eut la gentillesse de m’accueillir dans sa boutique pour deux séances de prise de vue dans le cadre d’un inoubliable atelier sur la narration photographique organisé à IFSAK par le photographe turc Dora Günel. C’était la fin de journée, Erol Bey avait l’air las et fatigué, nous avions peu à nous dire, mais ma présence et mon appareil photo — un discret GF1 et ses objectif pancake 14 et 20mm — ne semblaient pas le déranger. Je garde de ces séances un souvenir fugitif, assez tendre, légèrement mélancolique et teinté par l’obscurité montante de ces fins de journées d’hiver.
Je suis retourné le voir quelques fois par la suite (un pantalon, un blouson cuir qui lui donna littéralement du fil à retordre), et puis plus du tout, ayant déménagé un peu plus loin dans le quartier.
Trois ans plus tard, passant par là un jour de l’été 2014, j’ai demandé aux employés de la supérette d’en face pourquoi le rideau de fer de la boutique d’Erol Bey était fermé. Ils m’apprirent à mon grand désarroi qu’Erol Bey était décédé quelques mois plus tôt. Je me suis dit qu’il fallait peut-être que je parte à la recherche de ses proches pour leur donner des tirages, mais je n’en fis rien.
C’était la première fois que mourrait une personne que j’avais photographiée et une réalisation s’imposa à moi. Il ne restait plus que les photos.